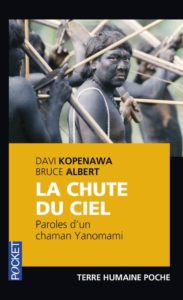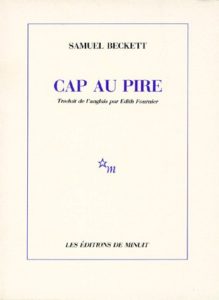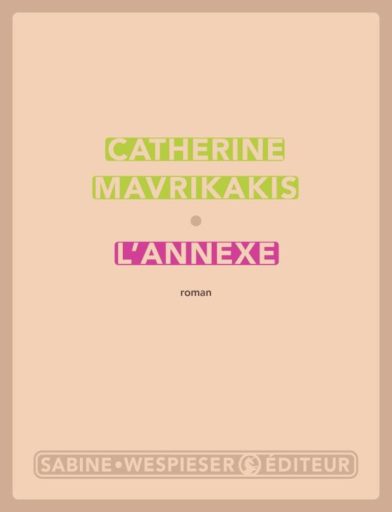Dans une vieille édition Gallimard cartonnée, rouge, qui fait penser aux livres d’enfance adorés parce que plein de secrets au moment de les ouvrir, mais à ceux aussi des bouquinistes entassés, moins aimés pour lors, ce texte de Giono, Colline, nous tient entre ses mains, par sa violence autant que par sa beauté. La colère des dieux, Giono la place, lui, au profond du vivant, et d’abord dans le langage. Les collines, aussi douces soient-elles, se mettent à bouger sous le regard inquiet de ses paysans. Le paysage cesse d’être un tableau et la mort attendue du vieux, personnage central réduit à un souffle, suspend tout le texte. Mais le vacillement a du bon. Joue contre terre, le monde écouté, presque palpé, y redevient sensible. Le cœur bat derrière l’écorce des arbres, le sang circule sous la bêche, et c’est bien à cette conscience d’une nature sensible que Giono invite ses personnages et ses lecteurs. Il éteindra le feu colérique, mais une fois ses braises attisées et comprises. Il mènera au bout du vivant, au plus près de la mort, vers une prise de conscience, l’Homme impropre. Sous la douceur trompeuse de Colline, il est un chemin de croix qui a moins à voir avec quelque religion qu’avec un panthéisme troublant. De Giono en revenant vers Ramuz, de Giono aux paysages aragonais de Llamazares, à traverser aussi certaines photos de Bernard Plossu, c’est une terre meurtrie qui fait sens mais dont les aspérités prouvent à l’homme qu’elle est encore vivante.

Jean Giono, Colline, Grasset, Cahiers rouges.