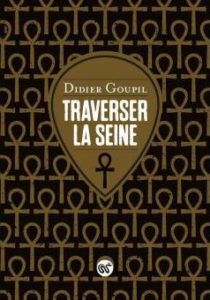Didier Goupil est un artiste de la dissimulation. Il est où on ne l’attend pas. Son souci pourrait être de lâcher son lecteur dans le trouble des illusions. Journal d’un caméléon, Les tiroirs des Visconti, ou même Femme du monde, autant de titres où l’on devine le goût de mettre en jeu l’artifice, de le dénoncer, celui de donner à voir derrière le monde des apparences.
Dans ce nouveau roman, Traverser la Seine, le nom du fleuve évoque le monde de la ville, Paris, dont le décor est dressé en quelques tableaux, comme un immuable mais fatal lieu d’une tragédie modeste et silencieuse, mais aussi le monde clos du théâtre, celui de la vie et des obsessions de la mort. Celui des histoires cachées, des maux sous les mots.
Traverser la scène, en évitant les regards sur soi, regarder devant, à droite, à gauche, et regretter l’insignifiance de la foule, la futilité des gens et la vacuité des situations, voilà ce à quoi Madame pourrait être assignée. Nous retrouvons ici le destin de personnages de papier, hérités de Beckett, de Pinget, ou ce que l’on nomma parfois abusivement du « théâtre de l’absurde ».

Dès le début de ce roman, dans son économie simple employé à moquer une société (bling-bling) obsédée par les parures auxquelles elle s’identifie, l’absurde est posé comme un ailleurs auquel on ne peut échapper. Pour échapper à l’abjection, il faut à Madame tout le recours à l’expérience de l’histoire, à la mémoire de l’horreur. La finesse de l’écrivain consiste à faire d’un personnage identifié « négativement » par sa position sociale, par sa richesse, l’héritière des vertus d’un monde disparu, messagère modeste d’une désillusion définitive. Le pire est passé par là, le pire étant cette histoire irréfragable, aussi indélébile que le tatouage de la honte sur le bras des déportés, l’histoire des camps, auxquels Madame n’a pas échappé, et n’échappe toujours pas, un demi-siècle après leur « ouverture ».
Dans La Lettre à Anna, Didier Goupil avait su déjà confier son désarroi devant l’histoire des industries de la mort et celle des jours d’« après ». Avec un art modeste du récit et l’usage de l’ellipse, il confronte à nouveau son lecteur à la douleur subie par chacune des victimes, au plus profond de leur vie, aussi longue fût-elle vécue. Cette douleur devient ainsi la nôtre, et son origine étend son ombre de mort aux soubresauts de notre présent.
De cette représentation par les mots, l’écrivain semble toujours insatisfait, comme s’il était impossible d’écrire le désarroi, le tourment, l’affliction, comme s’il était trop difficile de faire front à la puissance de l’illusion, au pouvoir des images et des slogans. Les blancs du texte contraignent le lecteur au silence, au goût du suspens, de l’attente. A ces blancs s’ajoute le recours à la peinture, à l’artiste qui donne à voir. Dans le Journal du caméléon, Didier Goupil nous avait conviés à la rencontre de Cosme Estève, un artiste qui prend le risque à pleines mains d’imprimer les rétines, héros barbouilleur d’un moment de littérature, homme pris dans le délire momentané des affects, dans la prison de la psyché. En une courte et belle scène, la peinture de Cosme Estève va éclairer de tous ses noirs ce texte étrange et émouvant, Traverser la Seine. Une belle méditation sur la vie. Et, on l’aura deviné, sur la mort.