 Le méridien de Greenwich comme l’équateur sont on le sait des lignes imaginaires. L’homme les a conçues par commodité pour l’aider à la cartographie du monde, pour le rendre intelligible.
Le méridien de Greenwich comme l’équateur sont on le sait des lignes imaginaires. L’homme les a conçues par commodité pour l’aider à la cartographie du monde, pour le rendre intelligible.
Peut-être en va t’il ainsi plus souvent qu’on ne le pense : l’homme a besoin d’habiter le monde physique aussi par des portions de territoires imaginaires.
La littérature trouve là une de ses raisons d’être. Une des tâches du romancier est de donner à lire une vision du monde. Mais le monde est multiple et complexe et l’écrivain peut avoir recours à l’imaginaire pour donner corps et réalité à ses visions.
« le démiurge n’a pas le monopole de la création. La création est le privilège de tous les esprits. La matière possède une fécondité infinie, une force inépuisable et en même temps une puissance de séduction qui nous pousse à la modeler. Dans les profondeurs de la matière se dessinent des sourires imprécis, de conflits se nouent, des formes ébauchées se condensent. Elle ondoie tout entière des possibilités inachevées qui la traverse de frissons vagues. Dans l’attente d’un souffle vivifiant elle oscille sans fin et nous tente par des millions de courbes molles et douces nées de son délire ténébreux. »
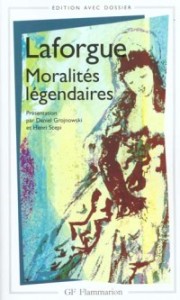 Moralités légendaires
Moralités légendaires
Jules Laforgue, Flammarion, 2000
Les récits de Laforgue ne relèvent d’aucun modèle connu.
Ils relatent avec la plus déconcertante désinvolture le mal d’aimer et le mal être, en entremêlant toutes sortes de références littéraires et culturelles. Ils se jouent des grands mythes et des œuvres célèbres en faisant alterner les jeux de la parodie, les bouffonneries sacrilèges, le récit poétique.
Ici, Hamlet pousse un dernier soupir en s’écriant : « Quel grand artiste meurt avec moi ! » là, Salomé débite des propos délirants à une assistance qui se demande à quelle heure on la couche.
A tout moment, le récit emprunte des voies buissonnières oú l’écriture s’invente dans l’exultation.
⇒ ÉCOUTER LA LECTURE DE NATHALIE VINOT
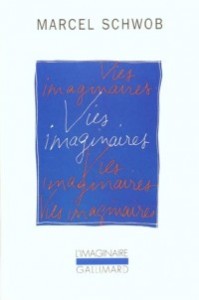 Vies imaginaires
Vies imaginaires
Marcel Schwob, Gallimard, 1994
«Le biographe n’a pas à se préoccuper d’être vrai ; il doit créer dans un chaos de traits humains. Leibniz dit que pour faire le monde, Dieu a choisi le meilleur parmi les possibles. Le biographe, comme une divinité inférieure, sait choisir parmi les possibles humains, celui qui est unique. Il ne doit pas plus se tromper sur l’art que Dieu ne s’est trompé sur la bonté. Il est nécessaire que leur instinct à tous deux soit infaillible.
De patients démiurges ont assemblé pour le biographe des idées, des mouvements de physionomie, des événements. Leur œuvre se trouve dans les chroniques, les mémoires, les correspondances et les scolies. Au milieu de cette grossière réunion le biographe trie de quoi composer une forme qui ne ressemble à aucune autre. Il n’est pas utile qu’elle soit pareille à celle qui fut créée jadis par un dieu supérieur, pourvu qu’elle soit unique, comme toute autre création.»
⇒ ÉCOUTER LA LECTURE DE NATHALIE VINOT
 Jardins statuaires
Jardins statuaires
Jacques Abeille, Gallimard, 2012
Découvrez Les jardins statuaires, le livre de Jacques Abeille. « En vérité je ne sais d’où ces statues tiennent cet air de présenter chacune à sa manière une déchirure profonde, et secrète, mais comment n’en serait-on pas touché ? » À une époque indéterminée, un voyageur parcourt un monde mystérieux où, dans des domaines protégés par de vastes enceintes, les hommes cultivent des statues… Inlassablement, les jardiniers plantent, soignent et transplantent les pierres. S’ils acceptent de guider l’explorateur dans leur étrange contrée, lui disent-ils tout des règles de leur société ? À la fois récit d’aventure, conte initiatique et rêve éveillé, Les jardins statuaires fascine par son ampleur et sa puissance évocatrice. Tapuscrit égaré, malchances et incendies ont concouru pendant trente ans à l’occultation de ce roman sans équivalent dans les lettres françaises.
⇒ ÉCOUTER LA LECTURE DE NATHALIE VINOT
 Le rivage des Syrtes
Le rivage des Syrtes
Julien Gracq, Corti, 1989
« Ce que j’ai cherché à faire, entre autres choses, dans Le Rivage des Syrtes, plutôt qu’à raconter une histoire intemporelle, c’est à libérer par distillation un élément volatil « l’esprit-de-l’Histoire », au sens où on parle d’esprit-devin, et à le raffiner suffisamment pour qu’il pût s’enflammer au contact de l’imagination. Il y a dans l’Histoire un sortilège embusqué, un élément qui, quoique mêlé à une masse considérable d’excipient inerte, a la vertu de griser. Il n’est pas question, bien sûr, de l’isoler de son support. Mais les tableaux et les récits du passé en recèlent une teneur extrêmement inégale, et, tout comme on concentre certains minerais, il n’est pas interdit à la fiction de parvenir à l’augmenter.
Quand l’Histoire bande ses ressorts, comme elle fit, pratiquement sans un moment de répit, de 1929 à 1939, elle dispose sur l’ouïe intérieure de la même agressivité monitrice qu’a sur l’oreille, au bord de la mer, la marée montante dont je distingue si bien la nuit à Sion, du fond de mon lit, et en l’absence de toute notion d’heure, la rumeur spécifique d’alarme, pareille au léger bourdonnement de la fièvre qui s’installe. L’anglais dit qu’elle est alors on the move. C’est cette remise en route de l’Histoire, aussi imperceptible, aussi saisissante dans ses commencements que le premier tressaillement d’une coque qui glisse à la mer, qui m’occupait l’esprit quand j’ai projeté le livre. J’aurais voulu qu’il ait la majesté paresseuse du premier grondement lointain de l’orage, qui n’a aucun besoin de hausser le ton pour s’imposer, préparé qu’ il est par une longue torpeur imperçue. »
Julien Gracq
⇒ ÉCOUTER LA LECTURE DE NATHALIE VINOT
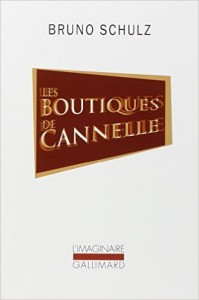 Les boutiques de cannelle
Les boutiques de cannelle
Bruno Schulz, Gallimard, 20005
Drohobycz, tranquille bourgade provinciale où Bruno Schulz vécut et enseigna le dessin, devient le lieu de toutes les terreurs et de toutes les merveilles : ses places, ses rues, la boutique familiale de draps et de tissus se métamorphosent. Dans une ambiance de sourde étrangeté, hantée par la figure emblématique du père, se déploient le thème obsessionnel des mannequins et le contraste, si spécifique à Bruno Schulz, entre beauté et pacotille.
Entre innocence et perversité, entre cauchemar et merveilleux, les récits des Boutiques de cannelle se situent dans un «treizième mois, postiche et superfétatoire, en marge du temps réel, sur ses voies de garage».
⇒ ÉCOUTER LA LECTURE DE NATHALIE VINOT
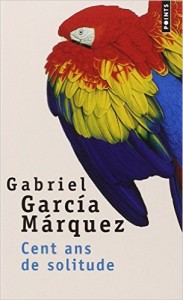 Cent ans de solitude
Cent ans de solitude
Gabriel Garci Marquez, Points, 1997
Une épopée vaste et multiple, un mythe haut en couleur plein de rêve et de réel. Histoire à la fois minutieuse et délirante d’une dynastie: la fondation, par l’ancêtre, d’un village sud-américain isolé du reste du monde; les grandes heures marquées par la magie et l’alchimie; la décadence; le déluge et la mort des animaux. Ce roman proliférant, merveilleux et doré comme une enluminure, est à sa façon un Quichotte sud-américain: même sens de la parodie, même rage d’écrire, même fête cyclique des soleils et des mots.
Cent Ans de solitude compte parmi les chefs d’œuvre de la littérature mondiale du XXe siècle. L’auteur a obtenu le prix Nobel de littérature en 1982.
⇒ ÉCOUTER LA LECTURE DE NATHALIE VINOT
 Les enfants de minuit
Les enfants de minuit
Salman Rushdie, Gallimard, 2010
Saleem Sinai, le héros de cet extraordinaire roman picaresque, est né à Bombay le 15 août 1947, à minuit sonnant, au moment où l’Inde accède à l’indépendance. Comme les mille et un enfants nés lors de ce minuit exceptionnel, il est doté de pouvoirs magiques et va se retrouver mystérieusement enchaîné à l’histoire de son pays. « J’ai été un avaleur de vies, dit-il, et pour me connaître, moi seul, il va vous falloir avaler également l’ensemble. » Alors se déroule sous nos yeux l’étonnante et incroyable histoire de la famille Sinai : disputes familiales, aventures amoureuses, maladies terribles, guérisons miraculeuses – un tourbillon de désastres et de triomphes…
Ce récit baroque et burlesque est aussi un pamphlet politique impitoyable. Elu en 2008 meilleur Booker Prize de l’histoire du prestigieux prix anglais, ce roman paru en 1980 a profondément influencé la littérature anglo-saxonne des trente dernières années.
⇒ ÉCOUTER LA LECTURE DE NATHALIE VINOT
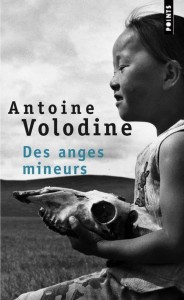 Des anges mineurs
Des anges mineurs
Antoine Volodine, Points, 2001
Ensemble narratif de quarante-neuf brefs textes, tous en rapport les uns avec les autres et qui peuvent donc être lus, en réalité, comme les chapitres d’un roman, Des anges mineurs est un livre d’une très grande force poétique.
Les personnages, aux noms farfelus, sont extrêmement âgés, mais jeunes parfois d’apparence. Ils ont échappé à une sorte d’apocalypse, en tout cas un changement de régime. Beaucoup ont séjourné dans des camps de redressement, et se plaignent, au fond, du retour au capitalisme. Ils ont souffert du totalitarisme, mais sont désormais dans une société où sous une autre forme l’humanité a disparu. Les rapports amicaux et amoureux sont clandestins et impossibles. Les rapports familiaux inexistants. La survie est presque impossible matériellement : ils vivent dans des grottes, sous des yourtes, dans des immeubles dévastés. Certains sont artistes, d’autres ont des responsabilités politiques. Mais tout va à vau l’eau. Le personnage central, Will Scheidmann est un écrivain qui, dans ce contexte de post-mutation de régime apparaît comme «réactionnaire», mais qui en réalité est le seul qui «réfléchisse» sur l’Histoire. Sa mère, accompagnée de vieilles femmes, veut exterminer : elle tient au respect des formes du nouveau régime. Mais l’exécution sans doute n’aura pas lieu.
L’ensemble est d’une grande tristesse, mais aussi d’une grande sensualité poétique, envoûtante. C’est brillant, intelligent : il y a d’admirables réflexions sur la littérature, ses illusions, ses limites, sa force aussi. Le livre est la description d’un monde où le temps, l’espace, l’économie, la littérature, les rapports psychologiques, la famille, la politique, les langues sont autres, «étranges». Il y a dans ce livre, en dehors des scènes très violentes, des moments de contemplation, de sensualité, de tendresse, qui l’ouvrent à des sensibilités plus diverses. Il tourne labyrinthiquement autour d’une obsession qui est, disons, l’apocalypse conçue par les hommes eux-mêmes, l’idée même de ce qui est «dernier».
⇒ ÉCOUTER LA LECTURE DE NATHALIE VINOT
